Pouvoir et progrès : Le combat millénaire inégal
- NAJIB BENSBIA
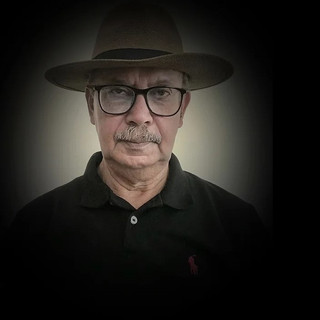
- 19 févr.
- 6 min de lecture
Dans un essai aussi engagé que documenté, ‘’Pouvoir et progrès, Technologie et prospérité, notre combat millénaire’", les économistes Daron Acemoglu et Simon Johnson démontent point par point la logique des grappes d’innovation chère à Schumpeter et la théorie néolibérale du ruissellement. Au terme de ce passionnant voyage à travers mille ans d’inventions peuplés de visionnaires (Ferdinand de Lesseps, Thomas Edison, Elon Musk…), vous ne pourrez plus dire que vous ne saviez pas, retranché derrière votre iPhone.

Les auteurs attquent d'emblée la question du progrès dans ses différentes facettees : Evolution agricole ou industrielle, intelligence artificielle, ordinateur quantique… autant de promesses d'une prospérité qui devrait naturellement ruisseler. La réalité est tout autre : la technologie est façonnée et confisquée par des élites qui assurent le maintien de l'ordre établi, de leur domination intellectuelle et de leur pouvoir politique. Pour le commun des mortels, le progrès n’est qu’un mirage, ou un vaste « enfumage ».
Après la parenthèse des Trente Glorieuses, les 40 dernières années n’ont fait que creuser des inégalités déjà criantes à coups de plateformisation, de délocalisation et de sape systématique des contre-pouvoirs. Les auteurs montrent qu’il est possible de rebattre les cartes, avec un peu de volonté politique et un minimum d’organisation de la société civile. Le combat est loin d’être perdu. Encore faut-il être conscient du danger et lutter contre une vision du progrès qui divise, isole et précarise jusqu’à ce que mort (sociale) s’ensuive.
Un manifeste constructif pour une croissance partagée qui concilie progrès, confort et reconnaissance de la valeur de chacun.
Extraits :
"
Chaque jour, nous entendons des chefs d’entreprise, des journalistes, des responsables politiques, et même certains de nos collègues du MIT nous dire que, grâce au progrès technologique, nous nous dirigerions vers un monde meilleur. Voici votre nouveau téléphone. Et voilà votre voiture électrique dernier cri. Bienvenue à la nouvelle génération de réseaux sociaux. Et bientôt, d’autres avancées pourraient guérir le cancer, résoudre le changement climatique, ou même nous débarrasser de
la pauvreté.
Bien sûr, des problèmes demeurent à travers le monde, dont les inégalités, la pollution et l’extrémisme. Mais ces douleurs accompagnent la naissance d’un monde meilleur. Quoi qu’il arrive, on nous explique que les forces de la technologie sont inexorables. Nous ne pourrions pas les arrêter même si nous en avions envie, et essayer serait une mauvaise idée. Mieux vaut se concentrer sur nous-mêmes, par exemple en investissant dans des compétences qui seront valorisées à l’avenir. S’il demeure des problèmes, des entrepreneurs et scientifiques de talent inventeront des solutions, comme des robots plus précis, une intelligence artificielle répliquant le cerveau humain, ou toute autre innovation dont nous aurions besoin.
Les gens comprennent bien que tout ce que nous promettent Bill Gates, Elon Musk ou même Steve Jobs ne se réalisera pas. Mais, au niveau mondial, leur techno-optimisme a infusé. Tout le monde, partout, devrait chercher à innover autant que possible, comprendre ce qui marche, et gommer les aspérités plus tard.
Nous sommes déjà passés par là, plusieurs fois même. On retrouve un excellent exemple de cette vision en 1791, date à laquelle Jeremy Bentham propose le panoptique, un dessin de prison. Selon Bentham, dans un bâtiment circulaire avec la bonne lumière, des gardes placés au centre du complexe pouvaient créer l’impression de surveiller tout le monde en permanence, sans être observés en retour – une manière très efficace (et peu coûteuse) de s’assurer d’une bonne discipline.
L’idée a d’abord suscité l’intérêt du gouvernement britannique, qui n’a cependant pas trouvé les financements et n’a donc jamais construit de prison selon ce modèle. Cependant, le panoptique a laissé une marque dans notre imaginaire collectif : pour le philosophe français Michel Foucault, en tant que système de surveillance et d’oppression au cœur des sociétés industrielles ; pour George Orwell dans 1984, en tant que mécanique de contrôle social omniprésent ; pour Marvel dans le film Gardiens de la galaxie, en tant que mauvais concept de prison permet tant une évasion audacieuse.
Avant qu’on ne propose le panoptique comme prison, c’était une usine. On doit l’idée originale à Samuel Bentham, le frère de Jeremy, ingénieur naval au service du prince Grigori Potemkine de Russie. L’idée de Samuel était de permettre à une poignée de contremaîtres de surveiller le plus de travailleurs possible. La contribution de Jeremy fut d’étendre le concept à d’autres formes d’organisations. Comme il l’expliquait à un ami : « Vous serez surpris quand vous viendrez et verrez l’efficacité de ce schéma pourtant simple et même évident en matière de gestion des écoles, des usines, des prisons, et même des hôpitaux… ».
Il est aisé de comprendre l’attrait du panoptique – surtout si vous êtes à la tête d’une organisation – et ses contemporains n’ont pas laissé passer cette information. Une surveillance plus poussée mènerait à un com portement millimétré, et il était facile de voir ce que la société pourrait en tirer. Jeremy Bentham était philanthrope, désireux d’améliorer l’efficacité de la société et d’aider tout le monde à être plus heureux, tout du moins selon sa vision du bonheur. On attribue à Bentham l’invention de la philosophie de l’utilitarisme, qui implique de maximiser le bien-être
combiné d’une société entière. S’il est possible de faire payer quelques individus un petit peu pour améliorer grandement le bien-être de nombreux autres, alors cela vaut le coup.
Le système panoptique ne portait cependant pas que sur l’efficacité ou le bien commun. La surveillance en usine impliquait également que les ouvriers travaillent plus, sans nul besoin de les payer davantage pour motiver ces efforts supplémentaires.
Les usines se sont progressivement répandues en Angleterre dans la seconde moitié du 18è siècle. Même si leurs dirigeants ne se sont pas bousculés au portillon pour créer des panoptiques, nombre d’entre eux ont organisé le travail en suivant les grandes lignes de la méthode de Bentham. Les manufactures textiles ont repris des activités auparavant réalisées par des tisserands qualifiés et les ont divisées en petites actions, dont certaines – particulièrement importantes – étaient réalisées par de nouvelles machines. Les directeurs d’usine employaient des ouvriers non qualifiés, y compris des femmes et de jeunes enfants, pour réaliser des tâches simples et répétitives, comme tirer sur un levier, pendant près de quatorze heures par jour. Ils surveillaient cette force de travail de très près, afin que personne ne ralentisse la production. Et ils versaient de très faibles rémunérations.
Les travailleurs se plaignaient des conditions de travail et des efforts douloureux impliqués. Les nombreuses règles qu’ils devaient suivre avaient tout particulièrement le don de les énerver. Un tisserand disait en 1834 : « personne n’a envie de travailler sur un métier à tisser mécanique ; on n’aime pas ça, il y a tant de fracas et de bruit que cela rend presque certains hommes fous ; et ensuite, cela nous force à nous soumettre à une discipline à laquelle un tisserand travaillant sur un métier manuel ne se soumettrait jamais ».
Les nouvelles machines transformaient les ouvriers en simples rouages.
Comme le déclarait un autre tisserand devant un comité parlemen
taire en avril 1835 : « Je suis pour ma part certain que s’ils inventent des
machines permettant de se passer de travail manuel, ils devront trouver
des garçons d’acier pour les faire tourner ».
Pour Jeremy Bentham, il était évident que les avancées technologiques amélioraient les écoles, les usines, et les hôpitaux, et que cela bénéficiait in fine à tout le monde. Avec son langage fleuri, son costume trois-pièces et son drôle de chapeau, Bentham détonnerait dans la Silicon Valley, mais sa pensée y est pourtant remarquablement à la mode. Les nouvelles technologies, nous dit-on, décuplent les capacités humaines et, quand on les applique à l’économie, améliorent grandement l’efficacité et la productivité. Et, si on suit cette logique, la société trouvera tôt ou tard un moyen de répartir ces profits, générant des bénéfices pour plus ou moins tout le monde.
Adam Smith, le père de l’économie moderne, qui vécut au xviiie siècle, aurait lui aussi pu rejoindre le conseil d’administration d’un fonds d’investissement ou écrire pour Forbes. Selon lui, de meilleures machines mèneraient presque automatiquement à de plus hauts salaires :
De meilleures machines, une plus grande dextérité et une division et distribution de travail mieux entendues, toutes choses qui sont les effets naturels de l’avancement du pays, sont cause que, pour exécuter une pièce quelconque, il ne faut qu’une bien moindre quantité de travail ; et quoique, par suite de l’état florissant de la société, le prix réel du travail doive s’élever considérablement…
Quoi qu’il arrive, toute résistance serait futile. Edmund Burke, contemporain de Bentham et Smith, parlait des lois du commerce comme « des lois de la nature et, par conséquent, les lois de Dieu ». Comment résister à la loi divine ? Comment résister à l’inexorable progrès technologique ? Et de toute manière, pourquoi résister à ces avancées ?
"
‘’Pouvoir et progrès, Technologie et prospérité, notre combat millénaire’’
Daron Acemoglu et Simon Johnson
Editions Pearson France - 2024



Comments