Procès du Mazan: Viol et consentement face à la loi
- NAJIB BENSBIA
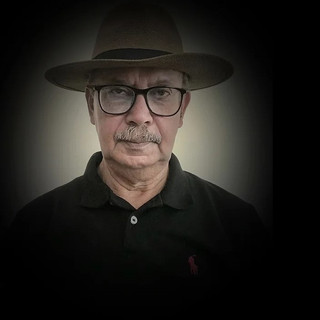
- 19 déc. 2024
- 7 min de lecture

Gisèle Pélicot à son arrivée au palais de justice d’Avignon, le 4 décembre. En refusant un procès à huis-clos dans l’affaire des viols de Mazan, elle est devenue une figure de la défense des victimes de viol. Christophe Simon/AFP In The Conversation
Depuis le projet de directive européenne de mars 2022 relatif à la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, auquel Paris s’était fermement opposé parce qu’il prévoyait en son article 5 une définition harmonisée du viol intégrant la notion de consentement, un débat s’est ouvert et perdure en France. Le président de la République s’est finalement prononcé au printemps dernier en faveur d’une nouvelle définition du viol et des propositions de loi sont déposées en ce sens.
Avec le procès des viols de Mazan, la question du consentement de la victime s’est trouvée relancée, en particulier du fait des avocats de la défense lorsqu’ils avancent que les accusés pensaient Gisèle Pélicot consentante sans qu’ils ne se soient pourtant assurés de cela auprès de cette dernière.
En France, moins de 1 % des viols donne lieu à une condamnation pénale. L’on peut donc légitimement se demander si une telle modification législative n’aurait pas un effet salutaire en termes de réponse pénale. Le viol est une des infractions les plus graves, c’est un crime sanctionné à l’article 222-23 du code pénal. Toutefois, ce n’est que depuis la loi du 23 décembre 1980, votée en réaction à un autre procès historique, celui d’Aix-en-Provence (1978), que le viol est défini dans la loi.
Or, cette définition, fortement inspirée par les féministes de l’époque – dont maître Gisèle Halimi, avocate des victimes violées par trois hommes –, est dépourvue de toute mention explicite au consentement ou plus exactement à l’absence de consentement. Ainsi, aujourd’hui encore, la définition du viol est la suivante : c’est un acte de pénétration sexuelle ou un acte bucco-génital commis sur la personne de la victime ou sur la personne de l’auteur par violence, contrainte, menace ou surprise.
Alors faut-il inscrire dans la loi qu’un viol est un acte de pénétration sexuelle ou un acte bucco-génital non consenti ? Si l’on s’inspire, entre autres, du droit pénal belge, cette inscription pourrait être ajoutée en préalable de la définition actuelle, ce qui permettrait de conserver les quatre adminicules que sont la contrainte, la violence, la menace ou la surprise. Solution de consensus qui peut s’avérer intéressante, tant l’idée divise.
Le risque d’un « procès de la victime »
Les tenants d’un statu quo invoquent que le propre d’un procès pénal est de décortiquer scrupuleusement le comportement et l’état d’esprit d’un agresseur pour déceler s’il a bien commis l’infraction de viol dans tous ses éléments constitutifs. Or, en intégrant l’absence de consentement dans la définition du crime, il est craint que la lumière soit désormais orientée vers la victime afin de détecter une éventuelle absence de consentement de sa part.
Il est ainsi redouté, notamment de la part de certaines féministes, que soit fait le « procès de la victime », drainant stéréotypes et préjugés pénalisant les femmes victimes – par exemple, des interrogations sur la tenue vestimentaire ou la supposée « extravagance » de celles-ci. À cela, l’on peut rétorquer que de nos jours, les comportements, les habitudes, les loisirs… des victimes de viol sont hélas passés au crible. Elles sont comme « déshabillées » une seconde fois dans les salles d’audience. Le procès des viols de Mazan l’a montré, au vu de ce qui a pu être dit et rapporté sur Gisèle Pélicot par la défense.
Crainte d’une mise en péril de la présomption d’innocence
Cette inscription dans la loi entraînerait, selon d’autres, un « brouillage » du procès pénal, au détriment de l’accusé cette fois, en ce que cela pourrait conduire à un renversement de la charge de la preuve et créer ainsi une présomption de culpabilité à son encontre. L’on craint alors une mise en péril des droits de la défense et de la présomption d’innocence.
Il reviendrait donc, pensent les mêmes détracteurs du consentement dans la loi, à l’accusé de prouver que la victime était en réalité consentante car, selon certains avocats (citons la prise de position de maître Basile Ader lors d’une récente conférence sur les viols de Mazan), le ministère public se contentera de croire les dires de la victime.
À cela, l’on peut rétorquer que c’est sur l’autorité de poursuite que repose la charge de réunir l’ensemble des éléments constitutifs d’un viol. Si l’absence de consentement de la victime venait à intégrer les éléments constitutifs du viol, il reviendrait donc au parquet de rapporter la preuve de l’absence de consentement de la victime, ce qui n’est, au reste, pas chose aisée s’agissant d’un fait négatif.
Une notion trop incertaine ?
Enfin, l’on invoque que le consentement est une notion floue et trop incertaine. Elle est, en effet, éminemment subjective et relèvera d’un difficile travail d’appréciation des juges. Des « oui » peuvent être contraints, par exemple s’agissant d’une relation sexuelle avec un supérieur hiérarchique. En somme, un consentement ne vaut rien s’il n’est pas totalement libre et totalement éclairé.
C’est aussi toute la question de la forme que doit revêtir le consentement à une relation sexuelle. Doit-il être forcément verbal ? Explicite ? Peut-il relever d’une attitude ? Être implicite ? Dans un arrêt du 20 octobre 1999, la chambre criminelle de la Cour de cassation a considéré l’attitude d’une plaignante ayant consisté à remettre un sous-vêtement à un homme lors d’une soirée comme constituant une invitation de sa part à un rapport sexuel avec cet homme.
Mais, reste aussi à déterminer l’objet du consentement, question là encore épineuse. Certes, il porte sur la relation sexuelle elle-même, pendant toute sa durée mais aussi dans ses modalités. Mais jusqu’où aller ? Les juges vont parfois assez loin lorsqu’ils retiennent par exemple, dans un arrêt du 23 janvier 2019, qu’il y a viol s’agissant d’une relation sexuelle qu’une femme avait acceptée avec un homme qu’elle avait rencontré sur Internet, dont le physique s’avèrera ne pas être aussi avantageux que celui décrit sur le site de rencontre. L’homme en question s’était dépeint comme un trentenaire au physique attrayant, (fausses) photos à l’appui… Il avait promis une « première rencontre exceptionnelle » selon un scénario bien détaillé : porte entr’ouverte, pénombre, bandeau sur les yeux (pour éviter de voir), mains attachées (pour éviter de toucher).
Au vu de telles solutions jurisprudentielles, faut-il alors présager qu’il y a viol en cas de rapport sexuel consenti entre deux personnes, si l’une d’elles tait le fait qu’elle est atteinte d’un virus mortel sexuellement transmissible ? Faudra-t-il retenir qu’il y a viol en cas de rapport sexuel consenti entre deux personnes dont l’une mentirait sur la véracité de ses sentiments amoureux ? Pourtant, l’intégration de l’absence de consentement dans la définition française du viol a ses partisans.
Changement de paradigme
En France, les victimes de viol sont à plus de 85 % des femmes. La définition actuelle de ce crime revient à dire qu’une femme est présumée consentir à tout rapport sexuel, sauf à démontrer l’existence d’une violence, d’une contrainte, d’une menace ou d’une surprise.
Inscrire l’absence de consentement dans la définition légale du viol, c’est renoncer à cette présomption de consentement. En découlerait un changement de paradigme dans notre société : on affirmerait ainsi que non, par principe, une femme en France n’est pas d’emblée consentante à une relation sexuelle.
Réduire les « zones grises »
En outre, il est avancé que l’intégration de l’absence de consentement permettrait de réduire les « zones grises ». Zones grises par exemple constituées par l’état de sidération ou d’intoxication d’une victime – ce qui est aujourd’hui désigné par soumission chimique lorsque sont utilisées certaines substances psychoactives – qui ne peut pas dire non, mais encore par l’état d’intimidation d’une victime qui n’ose pas dire non.
L’on constate aujourd’hui combien la jurisprudence n’a pas d’autre choix que d’interpréter très largement la contrainte et la surprise pour y faire « entrer » toutes les situations qui se présentent en pratique. À tel point que l’on a pu dire que la surprise était devenue un « fourre-tout ». Fourre-tout couvrant, sans aucune cohérence d’ensemble, aussi bien le cas où l’agresseur sexuel abuse de la vulnérabilité d’une victime droguée qui ne peut pas donner son consentement (comme l’illustre la présente affaire Pélicot), que le cas où il utilise un stratagème pour tromper et obtenir le consentement, par exemple en se faisant passer pour celui qu’il n’est pas.
Or, selon la Constitution française et plus exactement la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen dans son article 8, les incriminations pénales doivent être clairement et précisément définies dans la loi. En cela, certains estiment aujourd’hui pouvoir prétendre à une définition conceptuelle du viol reposant, de manière évidente, sur l’absence de consentement.
Portée pédagogique et expressive
Enfin, l’on avance que dire clairement dans la loi qu’un viol est un rapport sexuel non consenti aurait une vertu éducative non négligeable. L’on accorde en effet à la loi pénale un rôle préventif en raison de sa portée pédagogique, à condition qu’elle soit toutefois bien écrite en usant des concepts idoines, ce qui n’est pas le cas à l’heure actuelle.
Et puis, l’intégration de l’absence de consentement dans la définition légale du viol aurait indéniablement une portée symbolique, réaffirmant clairement que la valeur sociale ici protégée par le droit pénal est la liberté sexuelle dont chacun – au-delà de l’âge de 15 ans depuis la loi du 21 avril 2021 – dispose.
Cet article a été initialement publié sur The Conversation sous le titre " Procès de Mazan : comprendre les débats sur l’inscription du consentement dans la loi ".



Comments